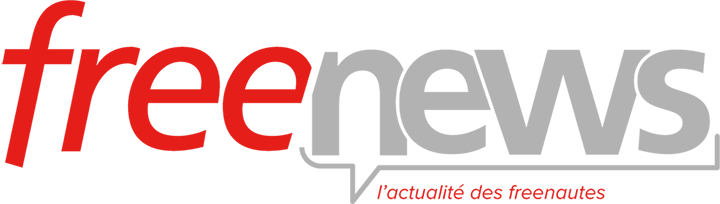Dans une décision rendue le 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux quatre principaux fournisseurs d’accès à Internet — Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile — de bloquer l’accès à une soixantaine d’adresses web associées à des sites de piratage selon Numérama. Cette mesure de blocage par la Justice et les FAI concerne 17 plateformes, principalement tournées vers le téléchargement illégal via BitTorrent ou le streaming non autorisé de contenus culturels. Le blocage des sites Torrent9 Cpasbien par la Justice avec elle concours des FAI soulève des questions sur l’efficacité de ces mesures.
Parmi les sites visés figurent des noms bien connus du grand public : Torrent9, Cpasbien, ou encore MonStream. Leur activité consiste à référencer et faciliter l’accès à des œuvres protégées sans autorisation, malgré une montée en puissance des offres légales comme Netflix, Spotify ou Amazon Prime.
Une stratégie de contournement systématique
Ce qui frappe dans cette ordonnance, c’est l’ampleur de l’action : 28 adresses concernent Torrent9, 8 pour Cpasbien, et 9 pour MonStream, preuve que ces plateformes multiplient les clones et les noms de domaine alternatifs pour échapper aux précédents blocages. Ces sites utilisent des extensions exotiques comme .ceo, .ninja, .men, .gd, .cz ou encore .lc, souvent liées à des juridictions plus souples en matière de régulation numérique.
Cette tactique de fragmentation complique le travail des ayants droit, des autorités et des FAI, dans une logique de chat et de souris numérique permanente. Les sites fermés réapparaissent rapidement sous une autre forme, et les blocages ponctuels, bien que nécessaires, peinent à faire disparaître durablement les plateformes.
Les FAI désormais tenus d’agir rapidement
Le tribunal a imposé aux FAI un délai de deux semaines pour mettre en œuvre les blocages, applicables pour une durée de 18 mois. Cette décision s’inscrit dans le cadre juridique français qui permet aux ayants droit de saisir la justice pour faire cesser les atteintes à la propriété intellectuelle, notamment via l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Ce type d’ordonnance repose sur un principe désormais bien établi : les FAI, même s’ils ne sont pas directement à l’origine des contenus diffusés illégalement, peuvent être contraints de bloquer l’accès aux sites fautifs, sans compensation financière.
Une lutte qui s’organise sur le long terme
La décision judiciaire souligne aussi que des dispositifs de mise à jour des adresses à bloquer sont déjà prévus, signe que les ayants droit ne comptent pas en rester là. Le système dit de « liste dynamique », adopté ces dernières années, permet d’adapter les blocages aux nouveaux domaines utilisés par les sites pirates, sans avoir à retourner devant le juge à chaque changement.
Cette évolution montre que la lutte contre le piratage est devenue plus technique et plus réactive, même si elle ne peut pas toujours égaler la vitesse d’adaptation des plateformes illégales.
Une régulation toujours sous pression
Le blocage ordonné par le tribunal de Paris n’est pas une première, mais il marque par son ampleur et sa coordination. En ciblant un large éventail de domaines associés à quelques plateformes emblématiques du piratage francophone, les ayants droit espèrent porter un coup significatif à leur visibilité.
Mais cette décision rappelle aussi les limites d’une stratégie uniquement basée sur le blocage DNS : tant que la demande existe, les sites pirates renaîtront ailleurs. D’où l’importance, en parallèle, de soutenir les offres légales et d’éduquer les utilisateurs à l’origine des contenus qu’ils consomment.