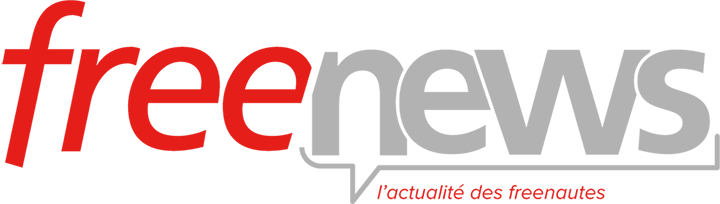En Europe, le secteur des télécommunications revêt depuis plusieurs décennies une importance économique et politique majeure. Les gouvernements y jouent souvent un rôle de premier plan, soit en tant qu’actionnaires directs, soit par le biais de participations étatiques dissimulées dans des entités publiques ou semi-publiques. Les politiques publiques encadrent ainsi le développement du marché, l’allocation des fréquences et la concurrence entre opérateurs. Qu’il s’agisse de la France, de l’Italie ou d’autres grands pays européens, l’implication de l’État se révèle déterminante pour façonner le paysage télécom.
Au regard de tous ces éléments, comment Free, opérateur bien connu pour son caractère disruptif, issu du groupe iliad, parvient-il à s’insérer dans des stratégies nationales parfois protectionnistes ? Et surtout, quelles perspectives se dessinent pour l’ensemble du marché européen d’ici 2025 ?
L’État actionnaire dans les télécoms : un panorama européen
Pour comprendre les nuances du marché des télécommunications en Europe, il convient d’abord de dresser un tableau de la participation directe et indirecte des gouvernements au capital des principaux opérateurs.
Historiquement, l’État français détient une participation dans Orange (anciennement France Télécom). Aujourd’hui, le pourcentage n’est plus majoritaire, mais l’État, via l’Agence des participations de l’État (APE), conserve 13,39 % des parts. Cette détention symbolique souligne la volonté française de garder un droit de regard sur un opérateur considéré comme fondamental, notamment en termes de réseaux et d’infrastructures sensibles.
L’exemple italien illustre particulièrement bien l’importance de l’intervention publique. Telecom Italia (TIM) est l’opérateur historique, et le gouvernement italien, par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts italienne, en détient près de 10 %. Des tractations récentes laissent entrevoir un transfert de cette participation à Poste Italiane, majoritairement détenu par l’État. Cette manœuvre cherche tout simplement à empêcher l’entrée d’acteurs étrangers, dont Free (iliad), au capital de TIM.
En Allemagne, l’État fédéral détient environ 31,9 % de Deutsche Telekom (via la banque publique KfW et d’autres organismes). Cette participation, encore significative, découle de la privatisation partielle de l’opérateur historique dans les années 1990. Le gouvernement allemand a toujours privilégié un modèle de libéralisation contrôlée, conjuguant ouverture du marché et préservation d’un « champion national ».
Telefónica est sans doute le groupe télécom emblématique de la péninsule ibérique. L’État espagnol n’en est plus actionnaire direct. Cependant, la proximité historique et un soutien politique de fait ont longtemps préservé l’opérateur de toute tentative d’OPA hostile. Malgré la réduction des parts publiques au fil des années, Telefónica reste considérée comme un actif clé.
Le marché britannique présente un profil plus libéral. Et l’on prend appui sur son modèle à l’échelle européenne, malgré sa politique marginale et le Brexit. British Telecom (BT), ancien opérateur historique, ne bénéficie plus de participation publique directe depuis sa privatisation complète dans les années 1980. Toutefois, la notion de « golden share » (action privilégiée permettant un droit de veto dans certains secteurs) a été évoquée à plusieurs reprises pour protéger l’infrastructure nationale, en particulier à l’ère du déploiement de la 5G.
Dans chacun de ces pays, l’influence publique varie, mais demeure un levier de régulation, voire de protectionnisme. L’État, en actionnaire plus ou moins déclaré, façonne les règles du jeu et peut accélérer ou freiner la concurrence.
Compétitivité des marchés télécoms au niveau européen
Sur le continent, la compétitivité télécom se mesure à travers plusieurs indicateurs : l’intensité concurrentielle, le niveau des prix, l’innovation technologique (5G, fibre optique) et la qualité de service. Ces indicateurs reviennent régulièrement au coeur des analyses de marché qui sont effectuées.
Les pays où l’on observe le plus grand nombre d’opérateurs (Quatre MNO ou plus) affichent généralement des tarifs plus bas et une concurrence tarifaire soutenue. La France en est un bon exemple : avec l’arrivée de Free Mobile en 2012, le prix moyen d’un abonnement télécom a rapidement baissé. En Italie, le phénomène s’est répété dès 2018, avec l’entrée d’iliad, même si la stratégie d’insertion sur le marché s’est faite de manière différente tout d’abord avec l’arrivée du mobile, préalablement à l’Iliad box c’est à dire en totale méconnaissance de la capacité de succès de la marque sur le marché.
L’observatoire européen des télécommunications relève que la France, l’Italie et la Finlande se distinguent par leurs offres parmi les moins chères d’Europe en matière de forfaits mobiles. À l’inverse, l’Allemagne et la Belgique maintiennent des prix plus élevés, en partie à cause d’un nombre réduit d’acteurs et de politiques nationales qui favorisent la stabilité financière des opérateurs historiques.
Les opérateurs soutenus par l’État peuvent profiter d’un accès simplifié à certains financements ou de facilités administratives, notamment pour déployer la 5G ou la fibre en zone rurale. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement pour moderniser leurs réseaux, tandis que l’Italie et l’Espagne tentent de rattraper leur retard, parfois en s’appuyant sur le plan de relance européen.
Free face aux politiques étatiques : un levier d’internationalisation ?
Fondé par Xavier Niel, le groupe iliad a depuis ses débuts misé sur l’innovation et la pression tarifaire pour s’implanter dans les marchés nationaux. Après la France, l’Italie est rapidement devenue un axe stratégique de développement.
Depuis 2018, Free (iliad en Italie) a réussi à séduire plusieurs millions d’abonnés, bouleversant un marché longtemps dominé par TIM, Vodafone et Wind Tre. Les offres à bas prix et une communication audacieuse ont permis à iliad de se faire une place non négligeable, malgré une couverture réseau initialement plus limitée.
Parallèlement, Free ne cache pas sa volonté de poursuivre sa croissance à l’international, que ce soit par l’acquisition d’actifs (comme récemment en Pologne avec Play) ou par l’examen d’opportunités de fusion. La tentative infructueuse de rachat de Vodafone Italie témoigne de l’audace du groupe. Désormais, l’opérateur se tourne vers TIM, mais se heurte à l’opposition des pouvoirs publics italiens, soucieux de préserver leur « champion national ».
Dans un pays où la participation publique reste élevée, l’avancée d’un groupe étranger est souvent perçue comme une menace. C’est particulièrement vrai en Italie, comme en témoigne l’initiative de faire entrer Poste Italiane au capital de TIM. Toutefois, cette stratégie défensive n’empêche pas certains rapprochements. Le PDG de TIM lui-même a reconnu que la fusion avec Free pourrait générer des synergies importantes et permettre à l’opérateur historique de moderniser rapidement ses infrastructures.
Des perspectives pour le marché européen en 2025 ?
D’ici 2025, plusieurs tendances majeures pourraient façonner l’avenir des télécoms en Europe.
Tout d’abord, le marché européen demeure éclaté, avec une multitude d’opérateurs nationaux et régionaux. Certains gouvernements encouragent la concentration pour créer de « grands champions » capables de rivaliser avec les géants américains ou asiatiques. D’autres, au contraire, encouragent la concurrence pour faire baisser les prix et stimuler l’innovation.
Parallèlement, la course à la 5G et à la fibre s’intensifie. Le soutien étatique peut jouer un rôle déterminant, notamment via des subventions aux opérateurs pour déployer le très haut débit dans les zones peu denses. Les opérateurs privés, Free en tête, devront continuer à investir massivement, tout en maintenant des prix compétitifs.
Il est vrai que la pandémie de COVID-19 a accéléré la digitalisation de la société européenne. Télétravail, télémédecine, enseignement à distance : autant de services nécessitant une qualité de réseau irréprochable. Les États exigent donc des opérateurs un niveau de performance élevé, et cela se traduira à la fois par plus de régulation et plus de financements publics.
Alors quelles stratégies de souveraineté adopter ?
Face à l’expansion de groupes américains (Google, Amazon) et chinois (Huawei), les États européens souhaitent sécuriser leurs réseaux. Cela passe parfois par le maintien d’un contrôle partiel dans les opérateurs majeurs (cas de la France avec Orange, de l’Italie avec TIM). Free devra ainsi composer avec ces exigences souveraines tout en poursuivant son déploiement international.
Un aperçu statistique : participation de l’État et dynamique de concurrence
Pour illustrer la diversité des situations, nous avons établi un diagramme simplifié (en pourcentage de participation étatique dans l’opérateur historique) et le niveau estimé de concurrence (nombre d’opérateurs mobiles principaux).
| France | Italie | Allemagne | Espagne | Royaume-Uni | |
| Participation Etatique | 13,39% | env. 10% | env. 32% | 0% | 0% |
| Nbre opérateurs mobiles majeurs | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
En France, la participation de l’État dans Orange est partielle (13,39 %) mais demeure influente, tandis que la concurrence s’avère très dynamique avec quatre grands opérateurs.
En Italie, autour de 10 % de participation de l’État dans TIM (bientôt potentiellement transférés à Poste Italiane), et quatre opérateurs majeurs, dont Free (iliad) qui a su capter une part de marché significative en peu de temps.
En Allemagne, la participation étatique est beaucoup plus élevée (environ 32 %), mais la concurrence est plus limitée, avec trois principaux opérateurs.
En Espagne, l’État n’est plus présent au capital de Telefónica. La concurrence y est soutenue, notamment grâce à l’émergence de MVNO et à la consolidation de divers acteurs.
Au Royaume-Uni, le marché est libéral depuis les années 1980, l’État ne détenant aucune part dans BT. Néanmoins, l’introduction de mesures de protection, telles que la « golden share », a parfois été évoquée pour préserver les réseaux critiques.
Mais alors : quelle politique adopter pour Free ?
Free doit poursuivre une approche à la fois offensive et pragmatique :
- Offensive, parce qu’en continuant de proposer des offres à prix compétitifs et en se positionnant sur les nouvelles technologies (5G, fibre, cloud) qui assurent une différenciation sur le long terme.
- Pragmatique, car l’opérateur est confronté à des marchés européens aux logiques étatiques très variables : des pays ouverts à la concurrence, et d’autres (comme l’Italie) où la protection d’un opérateur national prime sur la libéralisation.
La réussite de Free dépendra donc de sa capacité à s’adapter à ces écosystèmes hétérogènes tout en maintenant un modèle économique basé sur l’innovation et la transparence tarifaire. L’obtention d’accords de mutualisation ou de rachats partiels (voire d’alliances avec d’autres fonds d’investissement) pourrait s’avérer cruciale pour gagner du terrain dans les marchés difficiles.
En 2025, il est vraisemblable que le paysage télécom européen se soit resserré autour de quelques grands acteurs, soutenus ou non par leurs gouvernements respectifs. Free, fort de ses succès en France et en Italie, pourrait consolider sa place en tant que quatrième opérateur d’envergure européenne, s’il parvient à négocier avec habileté ces multiples contextes nationaux. À terme, le véritable enjeu consistera vraisemblablement à concilier l’indispensable expansion internationale avec les impératifs de souveraineté et de concurrence, afin de continuer à innover sans entraves.