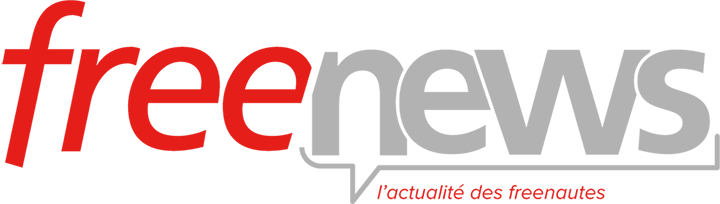Le marché des droits TV du football français connaît un nouvel épisode explosif. DAZN, actuel diffuseur de la Ligue 1, attaque la Ligue de Football Professionnel (LFP) en justice, réclamant la somme vertigineuse de 573 millions d’euros. L’argument ? Une « tromperie sur la marchandise », couplée à une lutte inefficace contre le piratage et un marketing jugé insuffisant.
Alors que la LFP pensait avoir sécurisé ses revenus télévisés avec DAZN, elle se retrouve désormais dans la position du défendeur, attaquée pour avoir, selon la plateforme, surestimé les revenus potentiels et négligé ses obligations contractuelles. Mais sur quelle base juridique DAZN s’appuie-t-elle pour exiger un tel remboursement ?
Une accusation de « tromperie sur la marchandise »
DAZN avance un premier grief majeur : les promesses de la LFP ne se seraient pas concrétisées. Le diffuseur estime que les perspectives d’abonnements et de revenus étaient largement exagérées lors des négociations. En clair, la LFP aurait survendu son produit, entraînant une rentabilité bien en deçà des attentes de DAZN.
Derrière cette accusation, on retrouve une possible invocation de la responsabilité contractuelle sur la base de l’article 1134 du Code civil français, qui impose la bonne foi dans l’exécution des contrats. DAZN pourrait chercher à prouver que la LFP a manipulé des chiffres ou omis des informations cruciales qui ont faussé son évaluation du marché.
Par ailleurs, si la LFP s’est engagée par écrit à garantir certaines conditions (comme l’ouverture des clubs aux équipes de DAZN pour du contenu exclusif), DAZN pourrait également invoquer un manquement contractuel, en s’appuyant sur l’article 1217 du Code civil, qui permet à une partie de demander des dommages et intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles.
Résultat : 309 millions d’euros sont réclamés au titre de cette « tromperie sur la marchandise », un montant qui reflète les pertes estimées par DAZN en raison du faible nombre d’abonnés et de la baisse des revenus escomptés.
Piratage et manque de soutien marketing : une responsabilité partagée ?
Le deuxième volet de l’accusation repose sur un manque de protection de l’exclusivité des droits. DAZN reproche à la LFP de ne pas avoir mis en place un dispositif anti-piratage efficace, permettant ainsi la diffusion illégale des matchs via des plateformes IPTV et des chaînes étrangères.
En demandant 264 millions d’euros supplémentaires, DAZN met en cause l’inaction de la Ligue face à un phénomène pourtant bien identifié. La LFP pourrait rétorquer que la lutte contre le piratage ne relève pas exclusivement de ses compétences, mais aussi des autorités de régulation comme l’ARCOM, qui dispose de dispositifs censés limiter ces pratiques.
Le contrat liant DAZN et la LFP pourrait contenir une clause de protection des droits audiovisuels, obligeant la Ligue à mettre en œuvre des actions concrètes contre le piratage. Si la LFP a promis des efforts renforcés et qu’ils n’ont pas été suffisants, DAZN pourrait invoquer une inexécution contractuelle et justifier une demande d’indemnisation.
De plus, DAZN critique également le marketing jugé insuffisant pour promouvoir l’offre Ligue 1. Ici, le défaut d’obligation de moyens pourrait être invoqué si la LFP n’a pas rempli ses engagements en matière de communicationet de soutien à la plateforme pour maximiser l’acquisition d’abonnés.
Un dossier explosif, mais des fondements fragiles ?
Si DAZN avance des arguments qui, sur le papier, peuvent sembler solides, la LFP dispose de plusieurs lignes de défense.
La LFP peut arguer que les chiffres étaient des projections et que rien ne garantissait à DAZN un nombre précis d’abonnés. L’argument est bancale mais il a le mérite de pouvoir être utilisé si la LFP est un peu habile et de mauvais foi ne nous le cachons pas.
Qui plus est, l’ARCOM et les autorités compétentes sont en première ligne pour lutter contre les flux illégaux, la LFP n’ayant pas la mainmise sur ces problématiques, ce qui engage un partage de responsabilités.
En dernier lieu, la LFP peut prouver que toutes les informations étaient accessibles publiquement, l’accusation de tromperie pourrait manquer de fondement juridique solide en entraver le principe de transparence.
Un tournant pour les droits TV en France ?
Cette bataille judiciaire pourrait avoir des répercussions majeures sur l’attribution future des droits TV. Si DAZN obtient gain de cause, cela pourrait ouvrir la porte à d’autres diffuseurs frustrés, remettant en cause la fiabilité des contrats entre la LFP et ses partenaires médias.
La Ligue 1, déjà en difficulté pour trouver un diffuseur stable, risque de fragiliser encore plus son attractivité si les diffuseurs actuels commencent à douter de la rentabilité de leur investissement.
Alors que les droits TV restent le nerf de la guerre pour le financement du football professionnel, cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre les diffuseurs et la LFP, dans un contexte où le modèle économique de la Ligue 1 est de plus en plus contesté.
Reste à voir si la justice donnera raison à DAZN ou si cette plainte finira par être un coup de pression destiné à renégocier les conditions du contrat. Une chose est sûre : l’avenir des droits TV du football français n’a jamais semblé aussi incertain.